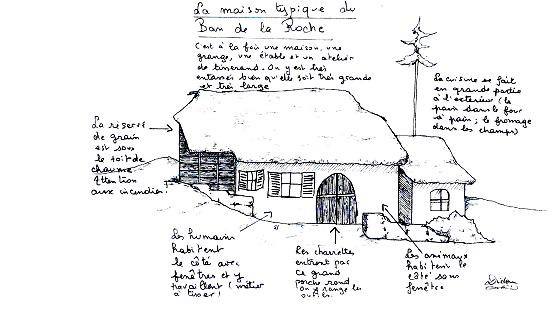Madame Stouber a pour servante une jeune fille de Belmont nommée Sara Banzet. C'est la nièce de Christmann Verly, receveur des biens de l'Eglise, l'un des conjurés dans l'affaire de l'agrandissement de la moté. Et de Jean-Nicolas Banzet, ancien de l'Eglise ou appelé à le devenir prochainement. Les Stouber lui transmettent deux de leurs passions : le tricot et la lecture.
C'est en 1762 que les choses sont en place pour une véritable alphabétisation des adultes. Grâce à l'aide financière d'un ami, Stouber a pu faire imprimer son " alphabet méthodique", ce qui permet enfin de faire la classe avec efficacité. Il a également obtenu de petites Bibles qu'il a vendu aux paroissiens en dessous de leur prix, ainsi qu'un certain nombre de livres qui constituent une bibliothèque de prêt.
Les Ban de la Rochois n'ont pas la tête aussi rétive à l'instruction qu'on a pu le dire. Anne Verly, mère de Sara Banzet, emprunte un livre de la grande mystique du Moyen Age Hildegard von Bingen : ce n'est pas exactement un auteur facile.
Quant à Sara, elle rédigera, en 1767, un journal dans un français parfait, avec un style que bien des écrivains pourraient lui envier.
Le bien être matériel de ses paroissiens préoccupe Stouber.
La première chose à faire, ce serait bien sur de préserver ce qui reste des bois, et même, si possible de reboiser. Le pasteur a sur ce sujet une longue entrevue avec M. de Régémorte, représentant local du seigneur Voyer d'Argenson. En pure perte. Les seigneurs tiennent à se réserver le bois.
Reste à mettre en œuvre les activités qui ne nécessitent pas de permission. Stouber fait venir des monitrices qui enseignent aux jeunes femmes à filer le lin et à tricoter.
En 1766, le presbytère de Walderbach reçoit une importante visite, celle du futur pasteur Oberlin.
En effet, Stouber, dont la santé est extrêmement fragile, doit quitter le Ban de la Roche et son terrain montagneux. Il a prospecté à Strasbourg pour se trouver un successeur. Le jeune Jean-Frédéric Oberlin lui conviendrait. Restera ensuite à faire entériner cette nomination par l'Eglise, et surtout, par le seigneur, qui est catholique.
Donc, aujourd'hui, les deux pasteurs parlent de ce qu'ils envisagent pour la paroisse, tant au plan spirituel que matériel.
Dans ce pays où l'on est toujours à la limite de la survie, il faudrait que les femmes puissent exercer une activité rémunératrice, mais pour cela …
" Il faudrait", dit Oberlin, " des conductrices de la tendre enfance, qui garderaient les enfants de tous et leur enseigneraient quelque chose pendant que les mères travailleraient."
L'instruction serait donc assurée, et, en même temps, le travail des mères produirait quelque chose ! Oberlin un véritable enragé au travail, adore ce genre de "coup double" ; il s'en délecte.
Pendant que les deux prédicants refont le monde, la jeune servante, Sara Banzet, ne dit rien, mais elle n' entend pas sourd.
Quelques mois plus tard, elle prend l'initiative de réunir les enfants chez elle, autour du poele. Chacun apporte une bûche s'il le peut et là, comme il fait bon chaud, on apprend à tricoter, on apprend des mots nouveaux, on apprend à lire.
1767 : Le changement de pasteur a eu lieu : c'est maintenant Oberlin qui est en charge de la paroisse de la vallée de la Chergoutte. Le "poele à tricoter" fonctionne.
Jean Banzet, père de Sara, n'est, paraît-il, pas trop satisfait de cette perte de temps.
Non que ce soit un mauvais homme, bien au contraire, d'après le journal de sa fille.
Mais il y a un petit problème : Jean ne sait pas écrire, il signe d'une marque, un petit cercle d'ailleurs tracé à la perfection. Ce qui le place déjà en position d'infériorité par rapport à sa femme, qui lit Hildegard de Bingen. Alors, si, en plus, il y a une deuxième femme savante dans la famille …
En réalité, Jean Banzet se fait trop de souci. Sara l'aime et le respecte. Son journal nous montre qu'elle fait grand cas de l'avis de son père et redoute un jugement négatif de sa part.
Quoi qu'il en soit, le mécontentement de Jean fait l'affaire d'Oberlin, qui, pour dénouer l'affaire, verse une petite rémunération à Sara et la recrute officiellement comme "conductrice de la tendre enfance".
DOCUMENTS
La Saint-Jean 1767
(Observation : on notera le caractère très sage et presque officiel de cette fête, probablement très récente au Ban de la Roche ; on se souvient que les feux de la Saint-Jean ne sont pas une tradition de la vallée ; la fête qui s'en rapproche le plus est celle des Bures, mais elle a lieu à une époque toute différente, et, au Ban de la Roche, elle ne paraît pas avoir résisté longtemps à l'introduction du protestantisme ; il est probable que le seigneur catholique est ravi de réussir à organiser une version sage des fêtes avec feu ; dans les villages catholiques voisins, le pouvoir spirituel, c'est à dire l'abbé de Senones, tempête tant qu'il peut contre les Bures et leur cortège de débauches et de grossièretés, mais sans succès
Le bois utilisé l'est avec l'aval de son propriétaire, puisque le feu est allumé par le "fiscal Kromer" : il s'agit d' un entrepreneur qui avait acheté d'importants secteurs à déboiser dans la région).
Extrait du journal de Sara Banzet"Le 25 de juin Pour fêter la venue de l'été enfin, et que la nature l'ait emporté sur le froid dur de ce printemps, si terrible dans les pluies et les neiges brutales, tous les bourgeois de Ban de la Roche se sont assemblés par ordre de Monseigneur l'Intendant, pour faire un feu de réjouissances en l'honneur de la clémence de Dieu.
Ce feu fut fait avec des branches d'arbres que les bourgeois apportèrent avec eux, et fut dressé par Jacques Scheidecker, bourgeois de Rothau, et allumé par Monsieur Kromer, fiscal dudit lieu, ensuite on se mit à danser alentour et à faire des décharges avec des pétards, et chaque bourgeois reçut pour souvenance une pinte de vin et pour un sou de pain. Ce fut une belle fête, les enfants étaient tout marmousés de sucreries aux myrtilles. Ils ont dit des poèmes, ont ballé comme les autres. J'ai reçu des félicitations pour leur tenue.
Monseigneur Voyer d'Argenson, jugeant de la festivité pour emporter son affaire, a entrepris de planter des bornes pour séparation des bois seigneuriaux d'avec les terres riches de Louise Pons de Clérisy : cela ne lui fut pas permis, c'est reporté à l'hiver, à la venue du notaire de la vallée."
|
ELEMENTS GENEALOGIQUES
Ascendance de Sara Banzet
Génération 11 Sara Banzet 1745-1774
Generation 22 Jean Banzet 1710-1773 x 3 Anne Verly 1715-1764
Generation 34 Georges Banzet 1680-1743 x 5 Anne Hazemann 1680-1719 6 Jean Verly 1687-1751 x 7 Régine Claude 1686 - 1751
Generation 48 Nicolas Banzet 1654-1695 x 9 Anne Wagner 1654- 12 Ulrich Verly ca1655- x 13 Marie-Christine Schaeffer ca 1660-
14 Claude Claude 1653-1700 x 15 Mougeotte Neuviller 1651-1704
Generation 516 Benoit Banzet x 17 Claudette N 24 Jean Verly x 25 Chrétienne N 26 Benoit Schaeffer x 27 Marguerite Roth
28 Nicolas Claude 1620- x 29 Mougeotte Jennin 1622-1682 30 Jean Neuviller x 31 Marie Thon
Génération 660 Joseph Neuviller x 61 Anne Ringelsbach 62 Humbert Thon, justicier, mari de 63, ou bien Gruson, diable, amant de la même ; 63 Madeleine Thon, sorcière
|
ENVIRONNEMENT INTELLECTUEL DE SARA BANZET
Observation : c'est par les registres paroissiaux que nous savons que telle personne signait d'une "marque" (croix, cercle ou autre …), d'une écriture maladroite ou d'une écriture cursive ; la signature des témoins sur de tels actes était facultative et n'apparaît que peu après 1700 ; Stouber semble s'en être servi de méthode pédagogique : ce devait être un grand honneur, pour un modeste Bémon, que d'être autorisé à écrire sur le grand livre du pasteur ; mais certains déclinaient cet honneur : il y a parfois, sur les actes, moins de signatures que de témoins ; en conséquence, lorsque nous voyons qu'un témoin signe d'une croix, nous devons en tirer les conclusions justes, à savoir que ce témoin fait, pour s'instruire, les tentatives qu'il peut ; il peut réussir plus ou moins, mais en tous cas, il fait des efforts ; un cas très notable est celui de Jean Banzet, père de Sara, dont la marque est un petit cercle si parfait qu'on le croirait tracé au compas (Jean a-t-il voulu, par cette perfection du dessin, se racheter de ne pas tracer de lettres ?) ;
Sara Banzet : lit et écrit à la perfection ; on peut l'appeler un écrivain
Anne Verly, sa mère : lit à la perfection des auteurs difficiles (Hildegard von Bingen, mystique allemande du Moyen Age)
Jean Banzet, son père : signe d'un rond absolument parfait
Ulrich Banzet, oncle de Sara : sait signer son nom d'une écriture maladroite, avec plus ou moins de succès selon les jours ; c'est la seconde syllabe de son prénom qui lui donne le plus de mal ; il arrive qu'il écrive Ulrique à la perfection, mais il arrive aussi qu'il écrive quelque chose comme Ulche ; effet d'états émotionnels différents ? A moins qu'il ne se soit posé trop de questions et n'ait été déstabilisé par le fait d'avoir un prénom à l'orthographe très inattendue, puisqu'il se termine, à l'écrit par le son ch, à l'oral par le son k
Marie Verly, femme d'Ulrich Banzet : signe son nom d'une écriture maladroite
Jean-Nicolas Banzet, beau-frère d'Ulrich, grand-oncle de Sara, ancien de Belmont : signe son nom d'une écriture relativement cursive ; clairement, on a là un des cerveaux de Belmont, ce qui explique sans doute ses responsabilités paroissiales éminentes ;
Nicolas Banzet, époux d'Anne Banzet, grand-oncle de Sara : signe d'une croix
Régine Claude, épouse Verly, grand-mère de Sara : je n'ai rien trouvé
Christmann Verly, fils de Régine Claude, oncle de Sara : signe d'une croix
… Claude, frère de Régine, signe d'une écriture que je n'ai pu déchiffrer, ce qui m'empêche d'indiquer son prénom
Ulrich Verly, grand-oncle de Sara, signe d'une marque très travaillée : une sorte de A, très penché, avec de grandes boucles
Jacques Claude, instituteur ; cousin germain de Régine Claude, elle-même grand-mère de Sara Banzet ; ce lien de parenté peut paraître relativement éloigné, mais Jacques (1721-1801) est, en réalité, pour Sara (1745-1774), un très jeune grand-oncle ; en outre, il est meunier au Trouchy, c'est à dire qu'il habite dans la même vallée ; on peut donc supposer des relations proches ; peut-être même est-ce Jacques qui a appris à Sara à lire et à écrire.
|
ELEMENTS GENEALOGIQUES
Les Scheidecker du Ban de la Roche,
dont un membre dressa le feu de la Saint Jean décrit par Sara Banzet
Génération 1 : Ulrich Scheidecker, o vers 1600 à Huttwill (Canton de Berne, Suisse) + avant janvier 1660 à Mulhouse (68) (noter combien cette famille a immigré tôt de Suisse en Alsace) ; x Verena Minder, (+ 10 août 1682 à Bellefosse ) ; d'où Caspar et Hans
Génération 2 : Caspar, marié avec Suzanne Hausenrieth (o vers en 1630 à Murten, Suisse, + le 27 novembre 1691 à Fouday, 67), dont Jean-Martin et Anne-Barbe
Hans Génération 3 : De Caspar : Jean-Martin, o 6 décembre 1660 à Barr, + 22 novembre 1742 à Fouday ; x 27 MAI 1692, Fouday (67), avec Jeanne MARCHAL 1669-, dont Jean, Bénédicte, Madeleine, Suzanne ; xx 2 février 1700, Waldersbach (67), avec Madeleine Marguerite MARCHAL 1680-, dont Odile et Jean Jacques
Autre branche Génération 1 Sébastien SCHEIDECKER, x avec Catherine CAQUELIN, dont Jean-Georges
Génération 2 Jean Georges., x Sara BERNARD, dont Sara Louise
Génération 3 Sara Louise, o 30 décembre 1791 ; x 29 octobre 1817 à Fouday, avec Joseph BERNARD, né le 5 août 1790, , Waldersbach
Autre branche
Génération 1 Didier SCHEIDECKER.x Sara LOUX, dont Catherine-Charité
Génération 2 Catherine Charité, née le 29 août 1789, Trouchy, x le 13 octobre 1824, Fouday, avec Jean CHRISTMANN, né le 9 avril 1798, dont Sophie
Génération 3 Sophie x Frédéric Julien CLAUDE.,
|
|